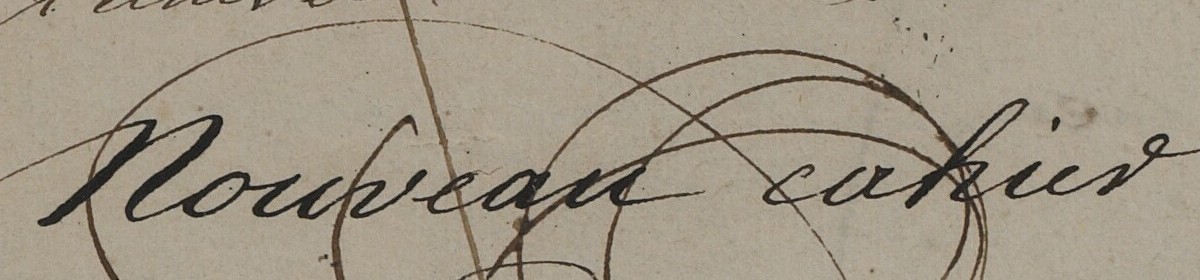L’Emmuré

Les Emmurés de Lucien Descaves est un roman qui paraît en 1894, c’est un roman naturaliste, qui évoque par son style aussi la prose recherchée de Huysmans – Descaves fut son ami et son exécuteur testamentaire. Le titre est clair quand on connaît le sujet : c’est un roman sur les aveugles, dont l’action commence en 1880 et rejoint progressivement le moment de l’écriture.
Le roman s’ouvre par la remise des prix à l’Institution des Jeunes Aveugles (l’INJA aujourd’hui) – qui fait penser à la fameuse scène des comices de Madame Bovary – où le narrateur épouse le regard curieux des observateurs, dans une description à l’écorché des différents visages d’aveugles, ce « jardin de la cécité », ce « parterre d’yeux fanés » :
Les ophtalmies apparaissaient à la fois artificielles et vivantes, cotonneuses et fermes, sèches et liquéfiées, lisses et rugueuses. Comme un palais dévasté, envahi par une végétation parasite, l’œil qu’un cataclysme avait désolé, appartenait aux fougères, aux lichens et aux mousses. Ils avaient tout recouvert, festonnaient le plâtre éraillé de la cornée, illustraient l’agate laiteuse et le jaspe panaché des prunelles où l’iris en dissolution s’extravasait à travers les parois perforées. Des globes dépolis, arides et rissolés, gardaient le ton et la rugosité de l’ardoise brute. Et d’autres, au contraire, arrosés incessamment, macéraient dans les larmes.
Mais cette extériorité acide dans son regard naturaliste ne dure pas, et dès le deuxième chapitre, l’auteur plonge son lecteur dans la conscience d’un jeune aveugle, Savinien Dieuleveult, tout juste diplômé de l’Institution. Plongée, véritablement, car en un véritable défi narratologique, la focalisation est presque toujours celle du héros. Descaves s’est attaché à rendre toutes les sensations d’un aveugle – comment il reconnaît les meubles, les pièces d’une maison au toucher, à l’odeur, les personnes à leur voix, et Descaves s’ingénie à trouver des métaphores pour caractériser les unes et les autres – à expliquer sa formation intellectuelle – comment il a appris à lire le braille, a acquis des notions de géographie, par exemple. Mais Descaves raconte aussi les nombreuses embûches qui attendent l’aveugle livré à lui-même : la dépendance envers les « guides », ces jeunes garçons qui lui permettent de traverser Paris, font les courses et le ménage, en échange du gîte et du couvert, le rejet des familles, pour qui l’aveugle est un poids mort, un sujet de honte que l’on cache, voire une personne que l’on peut spolier facilement, la solitude imposée, la crainte d’être rejeté.
Le projet du roman est toutefois plus ambitieux encore, puisqu’il parvient à dresser un véritable tableau social de la condition des aveugles à la fin du XIXe siècle, à travers les parcours de différents personnages, issus de l’Institution tout comme Savinien. C’est la grande question de la dépendance. L’Institution des Jeunes Aveugles, après avoir décerné des prix de musique à ses pensionnaires, se préoccupe peu de leur sort, sinon à verser quelques subsides en une charité à peine déguisée. Le travail d’un aveugle lui permet au mieux de survivre – car, comme le dit le texte, entre le travail d’un aveugle et celui d’un « clairvoyant », c’est toujours ce dernier qui sera favorisé. L’aveugle est-il alors condamné à la vie collective ? à ces ateliers, ces asiles, comme les Quinze-Vingt, qui sont comme une ville dans la ville, une « cité antique séparée du monde par un cataclysme et hantée par des revenants », avec ses codes et ses lois, parfois absurdes. Le risque est là, celui d’un « phalanstère où l’aveugle passera insensiblement de l’école à l’atelier, sans renoncer à la vie en commun », qui est une « utopie chère aux clairvoyants toujours instinctivement portés à isoler les aveugles ». Le roman dessine aussi toute une réflexion sur le braille, cette écriture qui permet aux aveugles de communiquer entre eux, mais qui reste hermétique à ceux qui voient clair – et ce sans remettre en question le progrès réel de cette invention, il faut le souligner.
En effet, parfois, le texte, dans ces grandes discussions, menacerait de tourner au roman à thèse, si Descaves n’avait le soin de ne pas trancher, prêtant des arguments forts à des personnages peu sympathiques, telle la femme de Savinien, bref, laissant le lecteur face à ses propres réflexions sur la condition de vie des aveugles dans notre société.

Si des personnalités qui se sont intéressées à la condition des aveugles apparaissent ou sont mentionnées dans Les Emmurés (Haüy, Braille), il n’y est pas question d’Augustin Thierry. Mais cette lecture m’a invitée à m’interroger sur les traces que l’on pouvait recueillir sur la manière dont il vivait sa cécité. Cette lecture, ainsi qu’une discussion avec Jacques Semelin, qui avait souhaité me rencontrer pour me poser des questions sur la méthode de travail d’Augustin Thierry – tout deux ont en commun de ne pas être né aveugle et de poursuivre des travaux d’historien en dépit de la cécité. Ce fut, mercredi 4 septembre, avec Giorgia Vocino, une belle après-midi, avec des échanges de part et d’autre, et de nombreuses questions en suspens.
Augustin Thierry était-il, lui aussi un « emmuré » ? Le titre même de ses brouillons, les « cahiers de la chambre », dessinent un espace clos, où la cécité se doublait de la paralysie. De cette chambre, il sortait porté par un domestique – et l’hypothèse qui nous arrête actuellement, Giorgia et moi, est qu’il s’agit aussi de l’un de ses secrétaires, celui dont l’écriture est la plus présente dans les cahiers. On en a en effet quelques témoignages, tel celui de Louis de Loménie, qui consacre à Thierry un chapitre de sa Galerie de contemporains illustres au début des années 1840. Au printemps, Augustin Thierry s’échappait de ses murs et allait à la campagne, où on le promenait dans une « petite voiture à bras, peinte en vert, et posée sur quatre roues ». Toutefois, dans les cahiers, c’est d’abord l’image d’un homme cloué chez lui qui domine.
Quant à sa méthode de travail, Augustin Thierry l’explique ainsi dans une lettre à un autre historien, Prescott, qui commençait lui aussi à devenir aveugle – rappelons qu’il n’a jamais appris le braille, qui se répand plus tard :
Vous me demandez, monsieur, si la Nécessité, mère de toute industrie, ne m’a pas suggéré quelque méthode particulière qui atténue pour moi les difficultés du travail d’aveugle. Je suis forcé d’avouer que je n’ai rien d’intéressant à vous dire. Ma façon de travailler est la même qu’au temps où j’avais l’usage de mes yeux, si ce n’est que je dicte et me fais lire. Je me fais lire tous les matériaux que j’emploie, car je ne m’en rapporte qu’à moi-même pour l’exactitude des recherches et le choix des notes. Il résulte de là une certaine perte de temps ; le travail est long, mais voilà tout ; je marche lentement, mais je marche. Il n’y a qu’un moment difficile, c’est le passage subit de l’écriture manuelle à la dictée. Quand une fois ce point est gagné, on ne trouve plus de véritables épines. Peut-être, monsieur, avez-vous déjà l’habitude de dicter parfois à un secrétaire : si cela est, mettez-vous à le faire exclusivement et ne vous inquiétez pas du reste. En quelques semaines, vous deviendrez ce que je suis moi-même ; aussi calme, aussi présent d’esprit pour tous les détails du style, que si je travaillais avec mes yeux, la plume à la main.
Ce calme et cette limpidité ne se retrouvent guère dans les cahiers de la chambre, si touffus, véritable agglomérat de premiers jets, de remarques, de notes de lectures, de brouillons de lettres, et de ce que l’on nommerait aujourd’hui des post-it. La recherche sur les secrétaires de Thierry, sur ses méthodes de travail – la dictée, l’écoute, en de nombreux va-et-vient – se poursuit donc, en parallèle d’un travail mené ces derniers jours sur l’édition des Récits des temps mérovingiens. Sans oublier de nouveaux projets de lecture, les livres de Jacques Semelin sur sa cécité – et lui ne se considère pas comme un « emmuré » : J’arrive où je suis étranger (2007) et Je veux croire au soleil (2016).